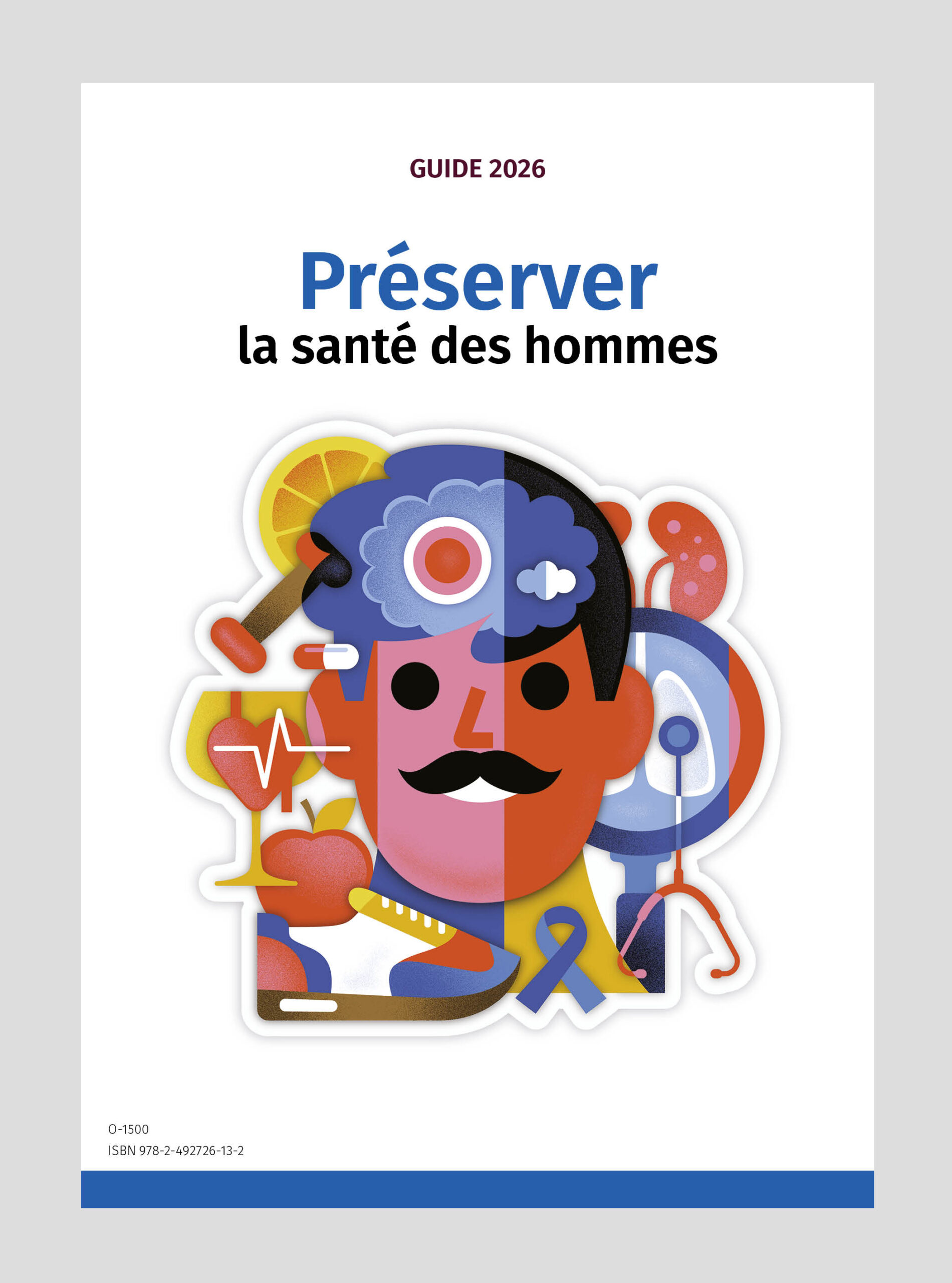Sécurité sociale : une octogénaire qui pourrait aller mieux
On célèbre cette année les 80 ans de la Sécurité sociale. Notre système de protection sociale peine à remplir correctement les missions pour lesquelles il a été conçu. La faute à l’accroissement de ses dépenses (allongement de l’espérance de vie, coût du progrès technologique) et à l’influence d’une dérive néolibérale, qui tend à préférer la rentabilité au bien-être des assurés.
Ambroise Croizat, syndicaliste et homme politique, membre du Parti communiste français, est le fondateur de la Sécurité sociale. Ouvrier ajusteur-outilleur puis secrétaire général de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et député de la Seine, il est ensuite ministre du Travail de 1945 à 1947 dans le gouvernement de Gaulle.
En application des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 émanant du programme du Conseil national de la Résistance, et en subversion de certaines lois promulguées par le régime de Vichy, notamment sur les retraites, il est chargé d’organiser la Sécurité sociale (assurance maladie, retraites, allocations familiales). Avec l’apport technique du haut fonctionnaire Pierre Laroque, il impulse la création du régime général de la Sécurité sociale qui sera mis en œuvre par les militants de la CGT. Pour « en finir avec la souffrance, l’indignité et l’exclusion et mettre l’homme à l’abri dubesoin. Et que la retraite ne soit plus une antichambre de la mort mais une nouvelle étape de la vie ».
Si les éléments de la Sécurité sociale existaient déjà avant-guerre, c’est Croizat qui rassemble en une seule caisse toutes les formes antérieures d’assurance sociale et finance l’ensemble par une cotisation interprofessionnelle à taux unique. Les allocations familiales, l’Assurance maladie, les retraites et la couverture des accidents du travail ne dépendent ni de l’État ni du patronat, mais d’une caisse gérée par des représentants syndicaux. En 1945, l’Assemblée consultative provisoire estime que le régime général socialise dès le départ le tiers de la masse totale des salaires. Sous son ministère, les allocations familiales sont doublées, la rémunération des heures supplémentaires augmentée de 50 %, l’abattement de 10 % sur les salaires féminins supprimé. II renforce les comités d’entreprise, organise et généralise la médecine du travail, réglemente les heures supplémentaires et crée le statut des mineurs.
Il met en place un régime général de couverture sociale qui non seulement mutualise une part importante de la valeur produite par le travail, mais qui en confie aussi la gestion aux travailleurs eux-mêmes.
Un nouveau système unifié remplace le préexistant millefeuille de couvertures par profession, par branche, par catégorie de salariés, par type de risque, auxquelles s’ajoutaient les mutuelles et les caisses syndicales et patronales. Née du programme du Conseil national de la Résistance (CNR) rédigé en 1944, la Sécurité sociale entendait imaginer « un ordre social plus juste » à travers notamment un plan complet de Sécurité sociale visant à « assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec une gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ».
Les trois principes, fondateurs, des ordonnances d’octobre 1945 sont : une organisation unique, un financement solidaire et une gestion par les partenaires sociaux. Celles et ceux qui travaillent et leurs employeurs financent un organisme indépendant de l’État, permettant de prendre en charge celle ou celui qui ne peut plus travailler du fait de la maladie, et leur famille.
La Sécurité sociale vise à couvrir cinq types de risques, qui forment les six branches de la Sécurité sociale : maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) ; famille (dont handicap et logement…) ; accidents du travail et maladies professionnelles ; retraite (vieillesse et veuvage) ; autonomie ; cotisations et recouvrement.
Qui détient le pouvoir sur la Sécu ? En 1945, c’étaient les partenaires sociaux, les syndicats (notamment la CGT) et les représentants du patronat et de l’État. Mais ce dernier va prendre progressivement de plus en plus de place dans le dispositif. En 1997, les élections des représentants des salariés à la Sécurité sociale sont supprimées ; et depuis 2004, le directeur général de l’Assurance maladie est nommé par le gouvernement.
Dans leur ouvrage Guide des intox sur notre système de santé, Olivier Milleron et André Grimaldi (médecins) soulignent que « reprendre le pouvoir sur la Sécurité sociale implique de revenir à une véritable cogestion entre l’État et des représentants élus des usagers et des soignants qui auraient un réel pouvoir dans un système transparent ». La gouvernance de la Sécurité sociale, rappelle pour sa part le Dr Christophe Prudhomme (voir interview page suivante), était paritaire jusque dans les années 50. Le conseil d’administration de la Sécu, c’était pour 75 % les cotisants, et 25 % le patronat. Puis le patronat a pris le pouvoir. Depuis les lois PLFSS Juppé, alias Plan Juppé de 1995, il n’y a plus de conseil d’administration, seulement des conseils « de surveillance » n’ayant plus de pouvoir de gestion de la Sécurité sociale. Il relève que cette année, le conseil d’administration de la CNAM a voté contre le PLFSS. Le gouvernement n’en a pas tenu compte et a utilisé le 49.3. Le conseil n’administre plus. Il ne gère que les attributions du budget d’action sociale, si peu de choses : 0,3 ou 0,4 % du budget. On assiste à la revanche des libéraux sur les créateurs de la Sécurité sociale.
Pour l’année 2026, un budget de rigueur
Le budget 2026, dont l’examen par les parlementaires débutera à l’automne, ne ménage pas la protection sociale. Il suscite d’avance une levée de boucliers, avec en particulier le reproche que l’essentiel des efforts demandés porte sur les classes moyennes et populaires… Claude Rambaud (vice-présidente de France assos santé) relève que « les projets de décrets visant à, encore, doubler le montant des franchises et des participations forfaitaires (qui l’ont déjà été l’an dernier) ont été transmis à la Caisse nationale d’assurance maladie ». Et alors que les textes de l’an dernier se voulaient « soucieux de préserver les personnes malades » et avaient maintenu les plafonds annuels, cette fois on tape sans discernement. « Sous couleur de responsabiliser les Français, poursuit Claude Rambaud, on cherche dans la poche des malades les 5 milliards d’euros qui manquent ». On oublie, souligne-t-elle, « la prévention et la chasse aux prescriptions non pertinentes. La surprescription coûte très cher ». Et l’association accuse : « Ces nouvelles mesures viendront donc encore entraver un peu plus l’accès aux soins et creuser les inégalités de santé. En choisissant les solutions les plus faciles et les plus courtes d’économies, le gouvernement punit les personnes malades et rejette les mesures qui permettraient une réelle efficience et pertinence des soins et des parcours ainsi qu’une politique bien plus stricte en matière de réglementation et de taxation des produits néfastes pour la santé, pourtant source d’économies substantielles et durables ».
Alain Noël
« Il faut sauver notre protection sociale »
Médecin urgentiste et syndicaliste CGT, Christophe Prudhomme dénonce le glissement de la protection sociale système solidaire non lucratif, vers un système privé, sous l’influence d’un mouvement néolibéral.
La Sécu a 80 ans. Bon anniversaire, malgré le déficit ?
Christophe Prudhomme : Rappelons d’abord que le « trou de la Sécu » n’est qu’un déficit comptable, qui est dû à ce que les recettes sont inférieures aux dépenses, en raison du vieillissement de la population, et du progrès technique et thérapeutique. Mais aussi à ce que les exonérations de cotisations sociales ne sont pas bien remboursées (via l’impôt, en principe. Cf. Loi Veil) par l’État à la Sécurité sociale. C’est un choix d’Emmanuel Macron, qui a décidé que les nouvelles exonérations ne seraient plus compensées. Ces exonérations, entre épargne retraite et prime Macron, représentent, ce qui aurait dû générer 18 milliards de recettes pour la sécu.
Mais l’État n’en a remboursé que 6 milliards en 2023. Or en 2023, le déficit de la Sécurité sociale a été de 12 milliards. Si l’État avait compensé comme il le devait, on aurait été à l’équilibre. Déficit comptable, oui. Le problème vient de ce que le financement de la Sécurité sociale est largement étatisé : 50 % des recettes dépendent de l’État, qui par le biais de l’impôt peut jouer sur le financement de la Sécu. Le déficit date du moment où l’État a pris la main sur la sécu. Voir la création de la CSG…
Est-il anormal que les dépenses de santé augmentent ?
C.P. : Bien sûr que non. Nos dépenses de santé, l’État a décidé qu’elles ne dépasseraient pas 12 % du budget de la Nation. Seulement, avec le vieillissement de la population et le progrès technique, les dépenses augmentent. Rappelons qu’en 1945, elles représentaient 2 à 3 % du PIB ; aujourd’hui, c’est 12 %. Le problème, c’est que l’État bloque le niveau des dépenses de santé. Et qu’on ne fait pas augmenter les recettes en fonction des dépenses. Aux USA, les dépenses de santé c’est 17 % du PIB, 5 % de plus, mais ce n’est pas un problème.
Que faire pour préserver notre système de soins ?
C.P. : Le réformer. Il faudrait une caisse unique assise sur les cotisations salariales et non salariales. Les revenus non salariaux (financiers) doivent être taxés à la même hauteur pour financer le système de protection sociale. C’est un choix idéologique : de la protection sociale système solidaire non lucratif, on bascule vers un système privé. Les néolibéraux veulent basculer les deux grands secteurs d’activité, éducation et santé, vers le marché, car ils ne sont pas assez rentables. Ils ne sont pas délocalisables. D’autre part le public est prêt à payer pour ses enfants et pour sa santé ! Le débat est : est-ce que la préoccupation santé est prioritaire ? On sait que le financement privé, assurantiel, n’est pas efficace. Mais cette année (comme les précédentes), on diminue le remboursement sur certaines prestations. Ce qui annonce le virage vers des assurances privées, et le remboursement dépendra de la cotisation qu’on a versée. Alors que pour la Sécurité sociale c’est : cotisation selon ses moyens, remboursement selon ses besoins. Le pouvoir politique sclérose le projet démocratique, monopolise les médias, empêche le débat. Mais quand on se bat, on marque des points !
Propos recueillis par Alain Noël