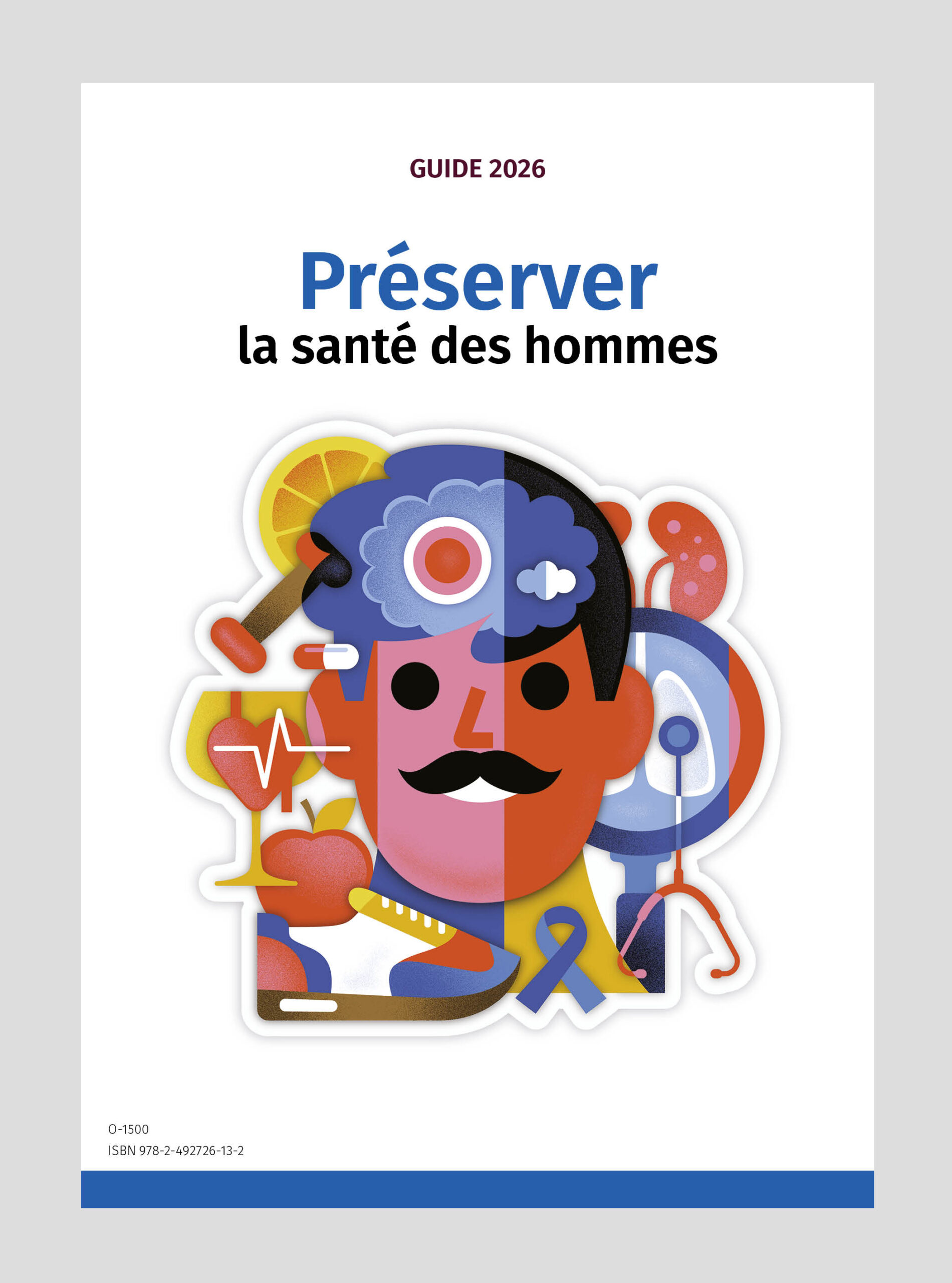Rester au domicile le plus longtemps possible
Perte progressive d’autonomie ne signifie pas obligatoirement placement en institution de type Ehpad. Des solutions alternatives existent, qu’il s’agisse d’aides aux tâches ménagères ou de soins à domicile.
Due à la sénescence ou à une pathologie, la perte d’autonomie impose la mise en place d’aides à la personne. Ce peut être l’intervention d’une aide à domicile, la livraison de repas, l’installation d’une télé-assistance. Ce peut être des soins à domicile, qui sont des soins infirmiers. Les soins d’hygiène et de confort (réalisation de la toilette) sont effectués par des infirmiers ou par des aides-soignants sous la responsabilité d’un infirmier. Les actes infirmiers (pansements, injections) ne sont dispensés que par un infirmier.
C’est le médecin qui détermine si quelqu’un a besoin de soins à domicile. Pour faciliter le maintien de l’autonomie, on peut recourir à un service autonomie à domicile (SAAD) qui succède depuis 2023 aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, aux services de soins infirmiers à domicile et aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile.
Les SAAD sont spécialisés dans l’assistance aux activités de la vie quotidienne : entretien du logement, courses, ménage, repassage ; aide aux levers et couchers, toilette, repas, soins d’hygiène, assistance administrative ; prévenir la perte d’autonomie via des activités intellectuelles, sensorielles et motrices ; accompagner la personne dans ses déplacements. Pour financer ces prestations, la prestation de compensation du handicap (PCH) peut financer en partie le coût de l’intervention d’un service d’aide à domicile si la personne est en situation de handicap et remplit les conditions. D’autres aides existent également comme l’aide sociale pour les personnes aux revenus les plus faibles. La personne ou ses proches peuvent contacter le Centre communal d’action sociale (CCAS) ou encore la mairie.
Des solutions plus médicalisées
En cas de besoin, une hospitalisation à domicile (HAD) est possible, permettant d’assurer, au domicile même du malade, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ce qui les distingue des autres soins à domicile est la complexité et la fréquence des actes effectués. Le champ d’application de l’HAD est divers : médical, post-chirurgical, obstétrique, soins de suite, traitement du cancer… Les soins d’hospitalisation à domicile les plus fréquemment réalisés sont les pansements complexes et les soins palliatifs.
Dans cette série de dispositifs, il ne faut bien sûr pas oublier l’infirmier libéral. Les infirmiers libéraux sont des infirmiers diplômés d’État, qui exercent seuls ou dans un cabinet composé de plusieurs professionnels de santé. Ils dispensent des soins au domicile de leurs patients, notamment des soins permettant aux personnes âgées de rester de vivre chez elles. Ils interviennent sur prescription médicale et 7 jours sur 7 si nécessaire.
Dans un autre domaine, des aides financières peuvent être accordées aux personnes qui sont âgées et vivent à domicile : allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, aides des caisses de retraite, aides fiscales portant sur l’impôt sur le revenu ou les impôts locaux…
Des solutions d’accueil temporaire peuvent également être envisagées. Que ce soit l’accueil de jour, l’hébergement temporaire en Ehpad ou chez des accueillants familiaux, un accueil temporaire est possible, à la journée ou au plus long cours pour les personnes âgées vivant à domicile. Ce sont également des solutions de répit pour leurs proches lorsqu’ils ont besoin de passer le relais.
Alain Noël